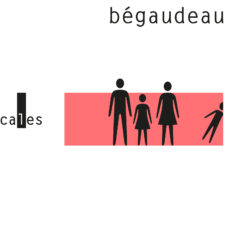Un prologue de brouillard, de cordes dissonantes, d’éclairs et de tonnerre ; en arrière plan symbolique une forêt romantique ouverte sur deux battants… puis arrive une charrette tirée par des gueux. L’un porte porte un poncho, il tempête autant que le ciel et s’ébroue comme une bête sauvage. L’autre peine et s’humilie devant la puissance de celui qu’il appelle Don Venceslao.
Ses premiers mots vont contre le temps, car pour Venceslao Dieu est mort depuis belle lurette, il hurle : PUTAIN DE MERDE !
Il en veut à la pluie qui mouille, à la boue qui embourbe, au cheval teigneux qui peine, et à cette charrette aux essieux rouillés. Symbole des misères de la saga sociale et familiale de cet opéra, la charrette traverse le temps et les espaces au fur et à mesure de la décadence et de la chute des personnages.
Je ne suis pas une spécialiste, mais qu’est-ce que ce spectacle m’a plu !
En fouillant les recoins de l’obscénité et de la tragédie humaine, je me suis régalée à rire non pas de, mais avec ces personnages auxquels la vie ne pardonne rien. La pauvreté de l’un sera criante de burlesque alors qu’il se saisit d’une poule (volée, car il n’a plus un sou vaillant) en hurlant, car pour le chant faudra pas trop compter dessus, l’homme perché en voix de tête, donc, hurle : « C’est dégueulasse une poule crue ! » On veut bien le croire. J’éclate de rire. (Oui, la greluche qui éclate de rire au second balcon comme une plouc dans l’antre grandiloquent de l’opéra de Clermont-Ferrand, c’est moi. Heureusement, je ne suis pas seule, à rire. Presque.)
Cette saga n’épargne rien au spectateur, le trépas scatologique, la séduction folle sur des airs argentins, et les trépidations médiocres de Rogelio devenu avocaillon sur des airs jazzy.
La partition et le jeu emportent par leur vivacité et leur éclectisme baroque.
J’ai adoré la mise en scène et la mise en lumière : tour à tour symbolique dans les accessoires, romantiques dans ses toiles tendues, surréalistes dans la présence des animaux et toujours surprenante dans ses enchaînements. Comme dans la galerie des tableaux immenses du Louvre, il y a des arrêts sur image, des compositions réalistes et romantiques qu’un Goya ne renierait pas.
Miroirs, rideaux, chute de soie, les textures sont multiples à l’image de ces personnages auxquels on s’attache malgré soi.
Les amateurs d’opéra classiques seront peut-être déçus par ces débordements salaces et populaires, par cette quête tragique de reliquats sociaux, mais il est parfois bon de ne pas être spécialiste et d’être emportée par un spectacle juste spectaculaire.
Je l’ai aimée la pute contralto amoureuse de Venceslao, je l’ai aimée cette China aux aigus permanents, vive, énergique, je l’ai aimé ce pathétique Largui perdu dans son pantalon comme dans son rôle, et je l’ai aimé ce Rogelio, amoureux minable d’une China rayonnante. Venceslao, héros éponyme, est le bon, la brute et la truand à lui tout seul, il m’a dégoûtée dans la scène de quasi-viol derrière un drap (jouée et sonorisée en temps réel), amusé quand il prend un bain (sur scène) et ému quand il décide d’organiser sa mort.
On ne retrouve pas les morceaux de bravoure chantés comme dans les autres opéras que j’ai vus, la question de la performance est ailleurs.
Vous dire, si c’était bon ou pas, je n’en sais rien, mais ce qui est sûr, c’est que c’était bien. Les mines réjouies et les applaudissements nourris n’ont pas contredit mon impression de néophyte.
Dalie
Martin Matalon (1958) : L’Ombre de Venceslao, opéra sur un livret de Jorge Lavelli d’après la pièce de Copi. Mise en scène : Jorge Lavelli. Décors : Ricardo Sanchez-Cuerda. Costumes : Francesco Zito. Lumières : Jean Lapeyre et Jorge Lavelli. Avec : Thibaut Desplantes, Venceslao ; Ziad Nehme, Rugelio ; Estelle Poscio, China ; Sarah Laulan, Mechita ; Mathieu Gardon, Largui. Orchestre Symphonique de Bretagne, direction : Ernest Martinez Izquierdo.